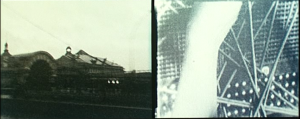Initialement écrit en 2010 à partir d’un texte de 2003, pour Scratch publée à Taipei en 2014 dans Stranger Than Cinema : A Study of Taiwanese Experimental Films organisé par Tony Chuin-Hui Wu
À Taipei, on trouve des cinéastes expérimentaux qui travaillent avec les moyens du bord. Jusqu’à la fin des années 90, l’intérêt pour le cinéma expérimental était très irrégulier, de plus, il était difficile pour la plupart des cinéastes et artistes, de retour, de continuer une telle pratique non seulement par manque de moyens mais manque d’accessibilité et visibilité à Taïwan.
Si la cinémathèque de Taipei a montré par le passé des films, elle n’accompagnait ni un mouvement, ni des cinéastes, quand bien même la production cinématographique sporadique de certains plasticiens et les nombreuses traductions que la revue de la cinémathèque a entrepris depuis les années 901. Le festival de Taipei de 2005, avait été exemplaire à cet égard en incluant de nombreux films et vidéos expérimentales contemporaines.
Jusqu’il y a peu de temps, presque tous les futurs cinéastes découvraient le cinéma expérimental lors de leurs études à l’étranger : Hsiu–Ching Wu, au début des années 90, est à Chicago où elle réalise quelques films dont A Play in Water (1992), avant de s’orienter vers un cinéma plus documentaire, une fois réinstallée à Taipei. Rue Yi Hung et Wu Chun Hui étudient à San Francisco. Ce dernier poursuivit sa formation à Bard, tout en organisant des programmes à Taipei dans le cadre d’Image Mouvement. Il a été l’un des rares à continuer de faire sur place des films avec la plasticienne Mei-ling Hsiao, qui a étudié au Fresnoy vers la fin des années 90. D’autres encore, récemment émigrés, décident de rester dans leur pays d’accueil. Pour ceux qui revenaient, le retour signifiait en tout cas, jusqu’au début 2000 l’abandon d’une pratique face aux difficultés rencontrées face à la culture cinématographique taiwanaise. Comme le reconnaissait Wu Chun Hui, les cinéastes n’avaient pas grand choix à leur retour :“ Ils doivent avant tout survivre, les seules solutions qui leur sont offertes sont l’enseignement ou le cinéma commercial, ce qui a pour résultat qu’ils continuent rarement de travailler le cinéma expérimental. ” Pour Vincent Wang, lui-même cinéaste2 : “ Toute la question est de savoir si l’on peut continuer à faire des films lorsqu’on sait que le gouvernement taiwanais ne reconnaît le cinéma que sous deux formes : les long-métrages ou les documentaires. ” Depuis cet entretien, en 2002, la situation a changé car l’enseignement de cinéastes et théoriciens a modifié le paysage et entraîné la production de films. Taiwan Video Club (1999) de Lana Lin illustrait cette dépendance entre la culture importée la production chinoise traditionnelle que l’on retrouve dans ces soaps et séries, consommées avec avidité par des générations de Chinois émigrés, comme l’illustre le documentaire.
Un grand nombre de cinéastes privilégient les formes courtes, s’exprimant à travers le documentaire, l’animation et parfois le cinéma expérimental, tandis que d’autres investissent le cinéma sous la forme de vidéos et d’installations, comme Mei-ling Hsiao, qui réalise parfois de courtes pièces : dans Lettre L’être (1996), le visage du peintre apparaît au fur et à mesure du transvasement de l’eau d’un récipient à l’autre. L’artiste Yin-Ju Chen fait appel à des formes courtes. Elle met en scène des micro-récits, quasiment des courtes performances, qu’elle filme de manière simple. Dans Untitled (2001), le visage d’une femme grimaçante, se tordant de douleur, fait écho au fait qu’elle donne naissance à un phallus : elle l’expulse de son corps. Des situations simples mais efficaces sont enregistrées sans commentaire, se suffisant à elles-mêmes : Escaping For a While nous montre une tentative de noyade dans un bol. L’artiste plonge son visage pour un long moment, puis relève la tête, reprend le bol et quitte le champ. Dans Recycle System (2002), elle nous propose une vision également absurde : elle passe l’aspirateur alors que le tuyau est connecté à sa bouche, faisant du corps féminin un aspirateur autonome. La position critique n’a pas à être soulignée, les images se suffisent. Depuis plusieurs années le monde de l’art accueille les propositions de cinéastes aussi bien sous la forme d’installation et approche critique permettant ainsi à des plasticiens et à des cinéastes de croiser les pratiques en atteignant d’autres publics. Taiwan n’échappe pas à cette inclusion du medium film part et dans le monde de l’art. La biennale de Taipei, mais aussi les revues comme Artco Monthly3 jouent un rôle dans la propagation du cinéma à travers le monde de l’art.
Le cinéaste Machunfu, privilégie l’animation. Il partage avec nombre de ses contemporains une exploration de l’animation selon une pluralité de registres4; il fait le lien avec le monde de la publicité, des vidéos clips et le monde de l’art. Mélange des genres mais aussi imbrications des techniques qui redistribuent les icônes de comics et de manga selon des modalités inattendues : Unblessed Love (2008). C’est le graphisme qui dynamise le traitement et la dynamique des images, ainsi dans Murder A Face (2005), le processus de destruction de document, papier est mis à profit afin de mettre en pièces (en lamelles) un portrait d’enfant en noir et blanc.
 La maîtrise technique rappelle les manipulations de photos de Spacy (1981) de Takashi Ito. Dans Lost in Remembering (2005) c’est la soustraction du même personnage à différentes étapes de sa vie qui interroge le souvenir selon un registre qui fait de l’effacement la condition d’une maîtrise et qui sait, de la survie. Par ailleurs on remarque que le cinéaste joue avec les jeux vidéos et son esthétique en recourrant au machinéma dans la série kodomo ?
La maîtrise technique rappelle les manipulations de photos de Spacy (1981) de Takashi Ito. Dans Lost in Remembering (2005) c’est la soustraction du même personnage à différentes étapes de sa vie qui interroge le souvenir selon un registre qui fait de l’effacement la condition d’une maîtrise et qui sait, de la survie. Par ailleurs on remarque que le cinéaste joue avec les jeux vidéos et son esthétique en recourrant au machinéma dans la série kodomo ?
La découverte du cinéma expérimental au cours d’études à l’étranger est révélatrice d’une attitude spécifiquement occidentale vis-à-vis du cinéma. On constate son importance et son influence dans les premiers travaux de Lana Lin, RueYi Hun, Anita Chang, Wu Chun Hui, Chen HsinWei. Certains de leurs films font état de préoccupations relatives au développement artisanal (Untitled, 2001, RueYi Hung). D’autres utilisent des found footage (I Begin to Know You, Through The Door, Sphere and Circle Round, 1992, Lana Lin ; Intimacy , puis More Intimacy (1999, Wu Chun Hui), Pluto 2008, de Yang Kai Yen, où affirment une subjectivité au travers des journaux filmés (A Play in Water, 1992 ; Untitled, RueYi Hung, Far Side of the Snow 2007 de Zhen Niam Kuo). Chacun s’approprie les images à sa manière : Lana Lin choisit de représenter l’activité des femmes, alors que Tony Wu utilise des images pornographiques homo dans Intimacy et ses variantes successives, qui trouveront un prolongement troublant dans Making Maps (2001). Dans ce film Tony Wu mêle à des images de jeunes garçons se baignant à la mer, en vacances des images pornographiques. Chaque série d’images induit des relectures en regard de celles qui les précèdent ou les suivent ; comme David Wojnarowicz, le faisait avec Untitled (One day this kid…,1990), dans une forme plus activiste en associant à la photo d’un jeune garçon un texte dénonçant ce qu’il endurera socialement en tant que gay. Le montage dense de Making Maps privilégie les éruptions sporadiques de grappe de photogrammes aux longues séquences, afin de dresser une cartographie potentielle des désirs. Making Maps utilise le sang et le sperme afin de créer des textures sur les images pornographiques autant qu’ils sont objets de la représentation, et comme on le voit parfois chez Andres Serrano5.
Certains artistes s’écartent de cette approche, privilégiant de longs plans (Chen Chieh-jen) ou le plan-séquence, comme Shuo-wen Hsia dans Intrude Sanctuary (2000) qui offre au regard un moment dans le métro de Taipei, alors que les défilent les stations, que les gens entrent et quittent la rame au son des annonces trilingues. Un film sans prétention qui rend indirectement hommage à Ernie Gehr, filmant les passants dans une rue de Brooklyn ou le temps qui s’écoule dans une avenue de Manhattan. L’écoulement du temps appréhendé différemment dans l’espace clos d’une caserne est à l’œuvre dans 03 : 04 (2000) de Ting Fu Huang. L’aspect photographique du documentaire restitue la banalité de la vie des conscrits, la rendant presque attrayante par sa plasticité. Quelques visages, quelques attitudes sortent de l’anonymat, tranchent sur l’ennui inhérent à l’enfermement. Sans commentaire, utilisant différentes vitesses d’enregistrement, le film dresse un portrait accablant d’une jeunesse confinée, réduite à un champ d’activités restreint, dans un lieu pour le moins désolé, une des îles dans le détroit de la Mer de Chine. Ici, comme dans She Wants to Talk to You (2001) d’Anita Chang (émigrée de la seconde génération, née aux Etats-Unis), où des Népalaises racontent leur expérience de l’émigration, c’est l’aspect expérimental du documentaire qui, au-delà des sujets, retient l’attention.
 Dans 30 : 04, l’utilisation de l’accéléré permettait de condenser l’expérience routinière des soldats, dans le film d’Anita Chang, le refilmage de documents et le développement manuel confère au film des textures, un grain, des taches et des rayures, qui deviennent la marque d’une subjectivité. Subjectivité de ces femmes qui commencent à faire l’expérience d’une certaine liberté. La personne déplacée est également au cœur du film de Lana Lin, Taiwan Video Club, comme de la courte fiction And Now Happiness (2001) de Tung Wang, qui oppose désir et religion dans la vie d’un garçon à New York.
Dans 30 : 04, l’utilisation de l’accéléré permettait de condenser l’expérience routinière des soldats, dans le film d’Anita Chang, le refilmage de documents et le développement manuel confère au film des textures, un grain, des taches et des rayures, qui deviennent la marque d’une subjectivité. Subjectivité de ces femmes qui commencent à faire l’expérience d’une certaine liberté. La personne déplacée est également au cœur du film de Lana Lin, Taiwan Video Club, comme de la courte fiction And Now Happiness (2001) de Tung Wang, qui oppose désir et religion dans la vie d’un garçon à New York.
Beaucoup de cinéastes d’origine taiwanaise travaillent sur la mémoire selon des modalités propres à chacun. Le journal filmé et l’évocation d’un temps plus ou moins distant sont à l’œuvre dans Grandma (2008) de Sumigyen et dans les films de Zhen Niam Kuo. Ces retours vers un ailleurs sont explorés plus systématiquement dans les films de Ming-yu Lee. Depuis That Day (2005) en passant par Going Home (2008)6 et jusqu’à Home Not Yet Arrived (2010) le cinéaste recourt prioritairement au super 8 où au téléphone portable pour réaliser ses films qui se focalisent sur de micro événements du quotidien, ou s’absorbent dans les regards et les gestes anodins, presque sans qualité et qui pourtant permettent de saisir une atmosphère, des émotions, des sentiments.
 Home Not Yet Arrived revêt la forme d’une lettre adressée au père décédé, l’informant de la vie familiale actuelle, et ce alors que le souvenir du père s’estompe et qu’on finit par y penser moins fréquemment. Les films sont développés par le cinéaste et souvent refilmés selon des stratégies évoquant les matérialités des laboratoires alternatifs d’Europe ou d’Asie. Sont privilégiés les liens que Ming-yu Lee entretient avec les groupes de super 8 et, avec le mouvement des laboratoires dont l’esthétique affirme similairement la matérialité et les spécificités du support argentique. La plasticité du portable est affirmée par de nombreux cinéastes contemporains et, qui à l’instar de Lionel Soukaz pensent que: « L’image est moins bonne que celle des caméras DV, mais elle est plus chaude, plus proche de l’image du super 8.7 ». De plus, comme le remarque justement Yung Hao Liu8, ce n’est pas tant l’authenticité qui est privilégie, bien que ce soit celle ci qui fasse écran au film, qui est recherché par le cinéaste que l’affirmation d’un style à travers le flou, le baclé, etc. Il partage cette volonté de ne pas se plier à une esthétique policée dominante que l’on retrouve chez quelques cinéastes et artistes contemporains.
Home Not Yet Arrived revêt la forme d’une lettre adressée au père décédé, l’informant de la vie familiale actuelle, et ce alors que le souvenir du père s’estompe et qu’on finit par y penser moins fréquemment. Les films sont développés par le cinéaste et souvent refilmés selon des stratégies évoquant les matérialités des laboratoires alternatifs d’Europe ou d’Asie. Sont privilégiés les liens que Ming-yu Lee entretient avec les groupes de super 8 et, avec le mouvement des laboratoires dont l’esthétique affirme similairement la matérialité et les spécificités du support argentique. La plasticité du portable est affirmée par de nombreux cinéastes contemporains et, qui à l’instar de Lionel Soukaz pensent que: « L’image est moins bonne que celle des caméras DV, mais elle est plus chaude, plus proche de l’image du super 8.7 ». De plus, comme le remarque justement Yung Hao Liu8, ce n’est pas tant l’authenticité qui est privilégie, bien que ce soit celle ci qui fasse écran au film, qui est recherché par le cinéaste que l’affirmation d’un style à travers le flou, le baclé, etc. Il partage cette volonté de ne pas se plier à une esthétique policée dominante que l’on retrouve chez quelques cinéastes et artistes contemporains.
Deux artistes plus anciens se distinguent : Wu Chun Hui et Chieh-Jen Chen. L’un venant du théâtre et du cinéma, l’autre des arts plastiques et plus particulièrement de la photographie.
Pour Wu Chun Hui, la rencontre avec le cinéma se réalise en priorité à travers le found footage. Travaillant à partir d’objets déjà filmés, on peut manipuler à son gré, surtout si l’on développe soi-même les images trafiquées à la tireuse optique. Dans le cas d’Intimacy puis de More Intimacy, une séquence de film porno homo, retravaillée, permet de montrer le rapport entre le grain de la peau et celui du film, et met en jeu notre capacité à trier les informations dans une image complexe. Que voit-on vraiment, qu’appréhende-t-on ? Ce qui est enregistré où ce que l’on aurait aimé voir enregistré ? En manipulant cette séquence, et grâce au jeu des surimpressions, le cinéaste crée des relations qui n’ont pas d’autre existence en dehors de la pellicule. Il induit des rencontres inédites, mais moins fortuites qu’elles ne paraissent de prime abord. Tony Wu propose de nombreuses versions de ses films: Cemetery en compte 7, sur différents supports : super 8 et 16mm, ou plus récemment la série d’installation et film Resurrection, qui en compte 5.
Dans Pycho Shower (2001), comme dans Intimacy ou Cemetery, le bleu domine.
 L’écran en est saturé. Hommage au film d’Hitchock, Psycho avec la scène de la douche,dans laquelle l’irruption du meurtre joue un rôle capital. Le refilmage de cette scène centrale procède par saccades. Les saccades, les délais, les retards étirent la scène initiale et la métamorphosent. Un univers s’ouvre alors. En ralentissant la scène, en la décadrant, le cinéaste convoque un passé cinématographique qui inclus non seulement le cinéma des années 60, comme la Jeanne d’Arc de Dreyer. La scène initiale s’étire (mais à la manière de Douglas Gordon), elle se replie afin de mieux se déployer selon des modalités qui rappellent les procédés utilisés par Raphaël Ortiz et Martin Arnold. Il ne s’agit pas de la citation d’un processus : le cinéaste propose une médiation sur le regard, sur la distance et la mémoire du cinéma, à travers le cinéma. Déconstruction de la scène image par image et remontage, un remixage qui ne respecte pas nécessaire la continuité initiale. Cette douche devient la mémoire d’un cinéma à venir. Tony Wu structure ses trois films grâce au travail chorégraphique qu’il accomplit avec les différents éléments mis en jeu. L’arrangement des mouvements, leurs reprises, les variations et permutations du cadre, d’un geste, les répétitions d’une action, d’un plan deviennent ainsi des moments dans l’acquisition d’un savoir, qui travaillent notre capacité à gérer l’information déjà vue. Il convoque nos souvenirs comme il le fera plus directement encore en introduisant dans Making Maps (2002) des séquences de home movies, montrant des enfants qui se baignent. Un futur éventuel est envisagé pour un enfant asiatique qui vit dans le monde des Blancs : écho lointain de la situation du cinéaste dans un monde dominé par le cinéma expérimental occidental.
L’écran en est saturé. Hommage au film d’Hitchock, Psycho avec la scène de la douche,dans laquelle l’irruption du meurtre joue un rôle capital. Le refilmage de cette scène centrale procède par saccades. Les saccades, les délais, les retards étirent la scène initiale et la métamorphosent. Un univers s’ouvre alors. En ralentissant la scène, en la décadrant, le cinéaste convoque un passé cinématographique qui inclus non seulement le cinéma des années 60, comme la Jeanne d’Arc de Dreyer. La scène initiale s’étire (mais à la manière de Douglas Gordon), elle se replie afin de mieux se déployer selon des modalités qui rappellent les procédés utilisés par Raphaël Ortiz et Martin Arnold. Il ne s’agit pas de la citation d’un processus : le cinéaste propose une médiation sur le regard, sur la distance et la mémoire du cinéma, à travers le cinéma. Déconstruction de la scène image par image et remontage, un remixage qui ne respecte pas nécessaire la continuité initiale. Cette douche devient la mémoire d’un cinéma à venir. Tony Wu structure ses trois films grâce au travail chorégraphique qu’il accomplit avec les différents éléments mis en jeu. L’arrangement des mouvements, leurs reprises, les variations et permutations du cadre, d’un geste, les répétitions d’une action, d’un plan deviennent ainsi des moments dans l’acquisition d’un savoir, qui travaillent notre capacité à gérer l’information déjà vue. Il convoque nos souvenirs comme il le fera plus directement encore en introduisant dans Making Maps (2002) des séquences de home movies, montrant des enfants qui se baignent. Un futur éventuel est envisagé pour un enfant asiatique qui vit dans le monde des Blancs : écho lointain de la situation du cinéaste dans un monde dominé par le cinéma expérimental occidental.
De la même manière, nos souvenirs sont envahis d’images qui ne nous appartiennent pas directement, mais que nous incorporons, que nous faisons nôtres : images de conflits, images pornographiques, clichés cinématographiques. Tout concours à faire de notre mémoire un paysage traversé d’images dont nous n’avons été que spectateurs. Les images font surgir les possibilités masquées qu’elles contiennent (le travail de Martin Arnold irait dans ce sens), ou bien elles sont le miroir9 de nos pensées les plus secrètes, images sur lesquelles on revient sans cesse. Le travail sur le retour des images irradie la pratique filmique de Tony Wu. Des images de Making Maps déclencheront Maps Dreaming (2001). Incarnation (Boy) donnera naissance à Re : Incarnation (Boy) (2003). On pourrait multiplier les exemples qui font du recyclage, de la recombinaison et du retraitement des outils de prédilection du cinéaste, qui prolonge un travail en jouant avec les variations.
On en trouve une récente manifestation dans la série : Resurrection ( 2006 à 2008)10. Cette série travaille la relation que les émulsions entretiennent à la photographie, à la vitesse et au cinéma. Le défilement et la granularité des émulsions, 16mm, Super 8 et 8mm accumulés au fil des ans lors de voyages en Europe s’opposent aux images gelées majoritairement en négatif dans Europe Ressurection (2006). Dans ce projet somme, Tony Wu, explore les seuils de perception et de reconnaissance des images qu’il avait entrepris avec exTaipeit (2005) qui associe quatre couches de flux d’images: travellings latéraux de plan des fenêtres de métros de différentes villes du monde et transcriptions rapides de textes, à quatre sources audio selon une construction qui induit conflagration et télescopage d’informations et questionne nos seuils de perception. L’impression de collage en flux domine dans ce film, alors qu’avec la série de Resurrection, l fait face à une mosaïque de mouvement et de textures produisant par couches de fragment concassé, une topographie de ville, dans Europe Resurrection et une ville : Paris plus précisément dans les trois opus de 2008: Last Night I Had a Dream, About My Mother, But I Could Not See Her Face et Paris Ressurection. Ce dernier se distingue par le traitement des photos, qui syncopé et parfois en surimpression sont trouées, déchirées, en lambeaux laissant apparaître la lumière et permettent ainsi la production d’images composite proche du vitrail. En ce sens l’esthétique déployée se rapproche de celles qui sont développées par Carolyn Avery ou Cécile Fontaine selon des techniques de décollages (liftings) des couches émulsives.
Cette série se singularise par la production d’image composite, images non-inscrites sur le ruban, mais que la pulsation cinématographique rend possible. La série se déploie selon des champs qui vont du personnel et de l’intime dans son usage de bandes de films dont on distingue de un à quatre photogrammes pour le premier opus de la série (Europe Resurrection), quittant progressivement le champ cinématographique pour affirmer par degré une dimension graphique et composite qui font entrer le travail dans un champ plus contemporain et proche d’une esthétique numérique, alors que les moyens utilisés ne le sont pas. Cette interrogation sur les vestiges d’un passé lointain ou proche, Chieh-Jen Chen, la met admirablement en scène dans ses photos et dans ses films : “ Je ne peux m’empêcher de regarder à ces images d’anonymes torturés, exécutés. Il semble qu’on peut voir par-delà ces images, d’autres couches d’images et de mots, latents, non dits. …/… Dans cette compulsion à regarder ces photographies, souvent je me voyais être la victime, ou le bourreau, ou un collaborateur de ces photos. ”11
Depuis quelques années, cet artiste a travaillé à partir de photos de supplices, de massacres ou de torture. Le supplice s’est toujours montré, a toujours été pensé sous forme de spectacle : on se souvient de la description étonnante de Michel Foucault qui ouvre Surveiller et punir.
Une des photos de la série Genealogy of Self est réalisée à partir d’une photo du supplice du Lingchi, prise en 1905 par Georges Dumas. La photo historique, agrandie et transformée, est à l’origine du projet cinématographique de Chen.
Il recrée, grâce au pinceau numérique, le supplice du Lingchi consistant à découper une victime en petits morceaux tout en évitant qu’elle ne meure trop rapidement. Comment ménager la victime et le spectacle ? À quoi pense la victime alors qu’agonisante, elle subit de nouvelles interventions, quel regard porte t-elle sur nous qui regardons ? Ces questions sont centrales pour comprendre le travail de la photo et du film. La scène du film a été tournée en 16mm, puis manipulée image par image. Lingchi – Echoes of a Historical Photograph (2002) existe en deux versions: en simple écran ou comme installation en triple écran – forme sous laquelle il a été montré lors d’une Biennale de Taipei (2002). Dans sa forme en installation, la dimension mystique du travail est soulignée par le choix du triptyque.
Suite de lents travellings latéraux et de plans rapprochés de la victime, le film est pour la plus grande part teintée en sépia. Il montre les instruments et la préparation du supplice, puis son exécution. On est immédiatement saisi par la qualité de l’image, qualité que l’on retrouve dans tous ses films. Les compositions minutieuses, les mouvements fluides et lents d’appareils plongent les scènes filmées dans un temps suspendu, qui permettra de constituer une mémoire d’un évènement, d’un lieu, par le changement de point de vue. Cette composition est comparable à celles dont la religion et l’art ont fait grand cas à savoir la représentation de corps souffrants ou hystériques. L’image est traitée comme le supplice : on n’est jamais directement confronté à la représentation du supplice, ce n’est ni “ gore ” ni même “ trash ”, et à la différence du Blow Job (1963) d’Andy Warhol, le hors champ n’est pas le moteur de représentation12. Avec ce film, Chen Chieh-jen (se) demande si l’on peut accéder à ce que pensent le bourreau, la victime lors de l’accomplissement d’un tel rite? Et que dire, des transformations provoqués par le spectacle d’un tel supplice, dans la psyché des spectateurs ? Seul un léger flou souligne la distance entre l’objet de notre regard – le supplicié – et le sujet qu’est le rite du supplice des huit couteaux. Par cet écart, nous pouvons continuer à voir encore et encore. Parfois, comme dans le Salo de Pasolini, la distance et le sentiment de voyeurisme sont accentués par l’irruption d’un photographe fabriquant un cliché stéréoscopique du supplice et de ses instruments. Il ne s’agit pas de body-art ou même de sa représentation13, tels que les promurent les actionnistes viennois ou les artistes chinois contemporains, mais plutôt d’une re lecture de l’histoire, à travers une reconstitution du supplice de la mort languissante. Tenus à distances, mais parfois nous passons de l’autre côté à l’intérieur du supplice, notre regard occupant la place des plaies. Nous sommes en présence d’une œuvre singulière qui interroge les techniques d’enregistrement d’un châtiment en faisant appel à l’histoire de ses représentations et à ses mésinterprétations culturelles. La souffrance du supplicié est muette, déréalisante elle finit par abolir les sens, d’où l’extrême malaise lorsque se fait entendre la présence ponctuellement un son sourd, transfert d’ondes électromagnétiques de la peau de l’artiste.
Le film interroge notre ambivalence vis-à-vis de la représentation de la violence, de sa mise en scène entre fiction et réalité, autant que les usages que nous en avons, que nous en faisons et ce d’autant que la photo du supplice et le film renvoient à l’économie du colonialisme et de son exploitation de l’exotisme qui évince l’autre confisquant toute parole singulière en dehors des siennes.
On retrouve le silence des exclus, des chômeurs, des déclassés dans d’autres films de Chen Chieh-jen, les ouvrières d’une usine de textiles dans Factory (2003), des étudiants, chômeurs, et sans abris dans Military Court and Prison (2007-08).
 À chaque fois, il est question de revenir sur un lieu, de revisiter des usines fermées pour cause de transfert de production vers d’autres pays, ou bien d’immeubles abandonnés, tours ou institutions judiciaires comme le tribunal militaire et sa prison afin d’inscrire une continuité malgré l’arrêt, l’abandon. Le film fait archive, il permet de constituer dans les lieux, la mémoire des outils de productions ou d’exclusions… Le film garde la trace, et permet d’écrire une histoire, de se réapproprier un évènement qui aurait pu avoir lieu; ainsi ce piquet de grève dans The Route (2006)14 des dockers de Kaohsiung, qui en 1997 avaient déchargé un cargo auquel les dockers du monde entier s’étaient refusés jusqu’alors face à la privatisation des docks dans le monde. Alors qu’ Empire ‘s Borders 1 (2008-09) met en jeu la disqualification d personnes désirant se rendre à l’étranger, par exemple aux Etats-Unis, ou à Taiwan. Les services administratifs refusant d’écouter les requêtes des voyageurs, des immigrants. Cette disqualification des personnes est devenue à ce jour l’une des techniques les plus utilisées par les démocraties du monde qui s’arroge le droit de laisser circuler les marchandises, mais pas les humains. Privés de parole et par conséquents de droits, les Chinois mariés à des taïwanais désirant se rendre à Taiwan, se retrouvent dans la même situation.
À chaque fois, il est question de revenir sur un lieu, de revisiter des usines fermées pour cause de transfert de production vers d’autres pays, ou bien d’immeubles abandonnés, tours ou institutions judiciaires comme le tribunal militaire et sa prison afin d’inscrire une continuité malgré l’arrêt, l’abandon. Le film fait archive, il permet de constituer dans les lieux, la mémoire des outils de productions ou d’exclusions… Le film garde la trace, et permet d’écrire une histoire, de se réapproprier un évènement qui aurait pu avoir lieu; ainsi ce piquet de grève dans The Route (2006)14 des dockers de Kaohsiung, qui en 1997 avaient déchargé un cargo auquel les dockers du monde entier s’étaient refusés jusqu’alors face à la privatisation des docks dans le monde. Alors qu’ Empire ‘s Borders 1 (2008-09) met en jeu la disqualification d personnes désirant se rendre à l’étranger, par exemple aux Etats-Unis, ou à Taiwan. Les services administratifs refusant d’écouter les requêtes des voyageurs, des immigrants. Cette disqualification des personnes est devenue à ce jour l’une des techniques les plus utilisées par les démocraties du monde qui s’arroge le droit de laisser circuler les marchandises, mais pas les humains. Privés de parole et par conséquents de droits, les Chinois mariés à des taïwanais désirant se rendre à Taiwan, se retrouvent dans la même situation.
Tout le travail de Chen se focalise sur la possibilité de renouer avec des histoires, avec une histoire avec son histoire qu’il s’agisse de celle d’une personne autant que d’un pays; la dimension politique est centrale: « Taiwan est devenue une société de consommation avec une grande facilité d’oubli qui a abandonné son droit de se conter et cela m’a incité à m’opposer à cette tendance. Ainsi chaque film que je réalise incarne une modalité de résistance, on doit voir chaque film que j’ai comme un acte de connexion, qui lie l’histoire des gens exclus du discours dominant, les situations de vie réelle de sphères ignorées ou isolés. Je m’oppose, ainsi à l’état d’amnésie dans la société de consommation. » Avec Empire’ Border II, Western Entreprises Inc (2010), Chen Chieh-jen continue son investigation sur les lieux de mémoire et leur effacement. Cependant bien que les architectures et les lieux de travail déliquescents sont voués à s’effacer, les corps conservent encore la trace de l’aliénation. L’espace du travail a marqué les corps qui êtres fantomatiques errent dans les anciens lieux de travail délocalisés ou bien inutilisés, car obsolètes. Dans ce film l’irruption de l’histoire du père en préambule, il fit partie en effet de la NSA (National Salvation Army). Cette unité était une organisation militaire mise en place par la CIA pour combattre la Chine communiste. Ce préambule modifie le rapport que nous avons aux lieux l’immeuble de la Western Entreprises Inc et aux ouvriers, soldats (mais le sont-ils qui hantent cette fabrique désaffectée qui était en fait l’immeuble de couverture de la CIA à Taiwan). L’étirement des plans fait surgir le Stalker d’Andrei Tarkovski, alors que leur plastique s’apparente à celle que travaillait Serguei Loznitsa dans ses documentaires ou films de compilations. La présence d’un son lourd en rotation constante s’interrompt brièvement pour faire entendre quelques échanges laconiques entre différents personnages se souvenant ou essayant de comprendre. Tout participe dans ce film d’une tentative qui vise à écrire, ré écrire une histoire qui a été effacée, évincée. Comment faire face à cette absence, comment un peuple, des hommes peuvent-ils élaborer leur histoire si celle-ci est marquée par ses hiatus, ses trous noirs. Tout le travail de Chin Chieh-jen se polarise sur cette question de la constitution d’une mémoire qui n’existe pas car elle a été délibérément annihilée. C’est ainsi qu’il faudrait alors comprendre l’importance du noir et blanc dans la majeure partie des travaux de Chen. Dans Empire’ Border II, Western Entreprises Inc ont fini par ce demandé si il s’agit vraiment de noir et blanc ; la plastique et le soin apporté au traitement des teintes, confèrent à ses films une dimension picturale indéniable.
La pluralité et la diversité des œuvres retenues remettent en question notre regard autant que notre aptitude à comprendre des cultures étrangères et dont nous n’avons en tout cas, en ce qui me concerne, qu’une connaissance limitée15. Pour reprendre les termes de son analyse, on pourrait dire que toute la difficulté réside précisément dans le fait que, nous nous attendons à voir ce que nous projetions d’y trouver. Et, si jamais cette attente n’est pas satisfaite, alors, notre jugement peut devenir négatif ; ce qui est dommage dans la mesure où la confrontation avec les cultures est justement ce qui permet d’envisager un dialogue c’est-à-dire ce qui permet de transformer notre regard. Mais dialoguer c’est envisager et confronter les points de vue, multiplier les interprétations.
yann beauvais
1 Yung hao Liu et Pai Zhang Wang ont traduit pour Film Appréciation Journal, le catalogue Le Je filmé (Centre Pompidou, ed scratch sous la direction de yb) n° 82, Taiwan Jui/Aug 96, de même celui sur Audio in Vision Out Mars avril 1999 à cet égard, exemplaire.les numéros 106 Jan Fev et 107 Mars Avril sur le super 8, coordonné par Wu Chun Hui en 2001, depuis de nombreux autres numéros ont été consacré où ont abordé le cinéma expérimental de manière plus régulière.
2 Cofondateur avec Pai-Zhang Wang d’Image Movement Cinematheque. Il a réalisé un film expérimental à San Francisco et travaille depuis 2002 sur un documentaire.
3 Sylvie Lin a écrit plusieurs articles sur différents cinéastes, vidéastes dans le cadre de cette revue.
4 Pour une mise en perspective des enjeux de l’animation contemporaine voir Dominique Willoughby : Le cinéma graphique; Editions Textuel, Paris 2009
5 Par exemple Untitled 8 (ejaculate in trajectory), 1989, ou Semen Blood 3, 1990
6 Dans ce film, plusieurs formats sont utilisés: super 8 et 16mm et Hi-8.
7 Le Monde 19/06/10.
8 Donner un peu de couleur au ciel, in Paysages du contresens, Lee Ming-yu, Commabooks, Taipei 2010
9 Sur les rapports entre mémoire et miroir, voir Lin Chi-ming, “ Mémoire, histoire, généalogie ”, in Asiatica II, Paris / Galerie du Jeu de Paume, 2001.
10 Cinq opus à ce jour.
11 Chieh Jen Chen : About the Form of my Works, http://www.asa.de
12 Roy Grundmann a consacré à ce film de Warhol une étude passionnante, Andy Warhol’s Blow Job, Philadephie, Temple University Press, 2003. Cette étude s’attach principalement à la représentation et au hors-champ.
13 Voir Kurt Kren et Otto Mühl ont filmé de nombreuses performances des actionnistes viennois tout en y participant.
14 Le film prend le pretexte des grèves ayant fait suite au chargement dans le port de Liverpool du Neptune Jade : http://www.iww.org/unions/iu510/jade/
15 Fei Davei à très bien analysé les limites de la compréhension d’œuvres par un regard étranger in Another Long March in Chinese Conceptual and Installation Art in the Nineties, Chris Driesen et Heidi Van Mierls, Fundamental Foundation, Breda 1997