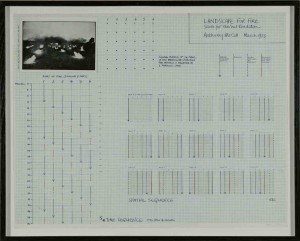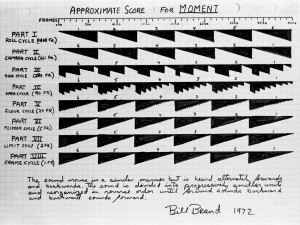Notes d’introduction pour quelques films des années 20 et 30
Le cinéma expérimental a toujours été habité par la musique. L’usage de la musique a permis a quelques artistes cinéastes de réaliser leurs travaux en suivant le développement de formes dans le temps. Si, dans un premier temps, la musique servait de modèle comme ce fut le cas principalement pour Viking Eggeling, Hans Richter, elle a été la source d’inspiration principale pour d’autres, leur permettant d’envisager l’avènement d’un art total. Un art qui permet de s’élever spirituellement tel que le souhaitait Walter Ruttmann qui le définissait comme « Une autre manière de donner une forme artistique nouvelle au sentiment de la vie, un art de peindre, projeté dans le temps. Un art visuel, se distinguant de la peinture du fait de son déroulement dans le temps (à l’instar de la musique) et du fait que le centre de gravité de l’objet artistique ne réside plus (comme dans le cas du tableau) dans la réduction d’un événement (réel ou formel) à un moment, mais précisément dans le développement temporel de son essence formelle [1] » (1919) et Germaine Dulac.
Les cinéastes voudront créer une musique des couleurs et par conséquent s’interrogeront sur la synesthésie. Pour d’autre l’étude du développement de forme dans le temps trouvera son illustration la plus féconde dans la musique et par conséquent la musique deviendra un modèle.
Les séparations entre ces approches sont fluctueuses, un cinéaste pouvant utiliser le modèle musical afin de constituer un travail, c’est en ce sens que peut se comprendre une partie des écrits de Germaine Dulac vis-à-vis du cinéma et de la musique, sans pour autant avoir défini distinctement tous les composants du rapprochement et encore moins sans établir une véritable synesthésie, elle indique comme tant d’autres des liens, des correspondances qui se manifestent à travers ces différents arts. De même Hans Richter se servant du contrepoint musical chez J.S . Bach selon l’explication que lui en donne Feruccio Busoni et qui lui permet de comprendre et modéliser le fonctionnement du rythme au cinéma
A l’avènement du film sonore, le recours à la musique donc au son offre de nouvelles possibilités d’organisation et peut s’envisager dès lors plus dans le champ du contrepoint et qui pouvait ainsi renouveler dans une grande part la musique d’accompagnement. C’est ainsi que peuvent s’envisager certaines partitions comme celles de Satie pour Entracte ou même
Les cinéastes se lancèrent dans la production de films abstraits en invoquant l’analogie musicale, envisageant tour à tour le cinéma comme rythme coloré (Léopold Survage), musique visuelle (Germaine Dulac), symphonie visuelle (Walter Ruttmann). Souvent ces approches font du cinéma celui qui englobe tous les arts, et c’est en ce sens que se comprend le recours à la synesthésie. Pour d’autres la métaphore musicale permet d’interroger l’essence du cinéma, en liquidant tous référents afin de le constituer en un véritable art autonome, et donc en le fondant. Ces questions amènent les cinéastes à découvrir et définir les spécificités de ce médium, ses qualités, ses potentialités. On empruntera au vocabulaire musical par défaut, mais on envisage la matérialité du cinéma, écran, rythme, dynamisme, photogramme… Richter parle d’orchestrer le temps, ou d’orchestration du mouvement en rythmes visuels
De nombreux rapprochements s’effectuent entre ces deux arts, Germaine Dulac en est l’un des meilleurs partisans : « La musique qui donne cette sorte d’au-delà au sentiment humain, qui enregistre la multiplicité des états d’âme, joue avec les sons et les mouvements… /…Le film intégral que nous rêvons tous de composer, c’est une symphonie visuelle faite d’images rythmées et que seule la sensation d’un artiste coordonne et jette sur l’écran [2]
La cinéaste manifeste son attachement à une spiritualité de l’art partagé par de nombreux cinéastes du début du siècle. Cette affirmation d’un art proche de la musique permet de cautionner le film comme art autonome et donc comme pouvant utiliser des objets abstraits (le rythme coloré de Léopold Survage, le film absolu de Walter Ruttmann et d’Oskar Fischinger, le film non objectif de Vikking Eggeling) mais aussi comme ce qui élève l’âme loin des contingences de la réalité et de sa simple reproduction. C’est au moyen de l’organisation des objets selon des vitesses et des rythmes précis que s’épanouie la Vision filmée dont parle Raoul Haussmann. S’affronte deux conceptions de la modernité dans laquelle le rapport au musical ne fait que souligner les divergences. D’un côté la métaphore musicale, au moyen de l’élévation de l’âme favorise un cinéma abstrait qui relève le plus souvent d’une approche romantique et d’une fascination pour la synesthésie dont les exemples les plus singuliers se trouvent dans les Opus (1919-24) de Ruttmann et dans les Filmstudies (1929-34) d’Oskar Fischinger ainsi que dans les tentatives d’orgues de Sandor Laszlo. Alors que pour une autre école, la référence à la musique est ce qui permet l’évocation de processus abstrait, elle est un moyen d’articuler les images entre elles au moyen du montage court et du rythme visuel. Ainsi Henri Chomette, Hans Richter s’emploient à développer un art qui travaille avant tout le rythme visuel, échappant ainsi à tout psychologisme et à toute histoire : « délaissant la logique des faits et la réalité des objets, engendre une suite de visions inconnues » (Henri Chomette). Ici le rythme est appréhendé comme ce qui permet d’organiser des éléments visuels disparates ; ce rythme fondateur dont Eggeling et Richter s’inspireront chacun sera tantôt rabattu du côté de la mélodie et des effets harmoniques (Eggeling, Ruttmann, Fischinger, Dulac) de l’autre sur la syncope et la vitesse (voir Richter, Chomette, Léger, Gance, Deslaw, Vertov). Le rythme c’est le battement et la mesure ; c’est ce qui scande le défilement des images dans le temps, ce rythme s’oppose à la mélodie des accords dans la mesure où il n’est pas une transcription du rythme musical mais l’application dans le champ cinématographique d’un élément de distribution (mélodie) des formes dans le temps.
Cette approche qui fait de quelques éléments du discours musical le moteur d’une altérité favorise la multiplicité d’approches et d’attitudes en fonction de ce que les cinéastes privilégient.
Les films que nous allons voir participe encore de cet engagement mais l’avènement du sonore en modifiant d’une certaine manière les conditions d’exploitation du cinéma impose une nouvelle économie de la production et de la diffusion qui accompagne par le plus grands des hasards une crise d’une rare violence aux États-Unis et en Europe. Le cinéma devient alors avant tout un objet de divertissement. Pour de nombreux cinéastes, l’expérimentation passe par une reprise de sujets, de gestes d’attitudes jusque-là délaissés. La question de la réalité et de sa reproduction dans tous ses aspects politiques et sociaux met à l’écart un type d’expérimentation au profit d’une autre plus proche de la question du documentaire et qui va nourrir des différentes expérimentations précédentes comme ce sera le cas en Angleterre avec les films de la GPO. Des cinéastes comme Hans Richter, Joris Ivens s’orientent vers une approche plus documentariste. Toutefois d’autres souhaitent maintenir tel Len Lye ou Laszlo Moholy-Nagy un cinéma de recherche. D’autres encore renouvellent l’approche en proposant un cinéma hybride. D’autres encore s’alignent sur un certain retour à l’ordre, dont on retrouve une des traces au travers de l’usage de forme musicale du passé.
Ballet mécanique 1924 Fernand Léger, Dudley Murphy
Musique de Georges Antheil, version de David Kershaw
Ce ballet n’est pas que mécanique. Il participe de l’esthétique moderniste, il en serait un des canons cinématographiques. Il s’agit d’une œuvre coréalisée dont, on ne peut déterminer la parfaite genèse mais, dont Jean Michel Bouhours à proposer il y a quelques années une des analyses les plus pertinentes lors de la rétrospective Fernand Léger du Centre Pompidou. Il met l’accent sur la perte d’un des éléments majeurs de l’esprit du film qui correspondait à l’humour grinçant de Man Ray. (tel cet enchaînement de plan associant le ventre rond de sa femme enceinte avec des pistons).
Il semble que le film ait sa source dans les travaux qu’entreprirent Man Ray et Dudley Murphy avant que Fernand Léger s’en mêle.
C’est par l’entremise d’Ezra Pound que Georges Antheil est associé au projet. À la suite du concert du 4 octobre 23, au théâtre des Champs-élysées dans lequel il joue sa dernière composition, il déclare travailler sur une nouvelle pièce intitulée ballet mécanique pour laquelle il recherche un accompagnement cinématographique.
En réalité, le film est bien plus connu que ne l’est la partition du même nom. Ou plus précisément leur reconnaissance est distincte.
Le film fut montré à Vienne mais sans le synchronisme musical d’Antheil, des tentatives de synchronisme virent le jour à Paris, mais sans succès.
La pièce musicale d’Antheil ne fut jouée à Fernand Léger que plus tard, et ce bien après sa présentation au Carnegie Hall en 1927. Les avis cependant divergent sur les présentations publiques à Paris des 25.
Le ballet mécanique faisait appel à 16 pianos mécaniques, il fut récrit pour un piano mécanique et huit pianos avec un accompagnement de percussion important d’un moteur d’avion, de klaxons et d’une hélice. Il existe de nombreuses versions de cette pièce.
Il y a plusieurs domaines particulièrement intéressant dans cette partition partie lesquels on peut retenir à la fois celle qui consiste à recourir pour une pièce de concert à la bande perforée du pianola, qui permet d’envisager une musique quasiment robotique, écho musical de ce mécanique ballet, proche en cela du machinisme des futuristes. L’usage de cette bande permet d’obtenir une composition complexe inspirée d’un ragtime.
Le film et la musique partage l’usage de la répétition d’un même élément, d’une même note, d’une même figure, mises en boucle. On anticipe un usage qui sera généralisé plus tard par les musiciens et les cinéastes dans les années 60.
Voir la scène de la lavandière qui remonte un grand nombre de fois un escalier.
Cet usage de la boucle, qui sera radicalisé dans certains films de Charles Dekeukelaire dont Impatience de 1928, est appliqué avec la musique dans Limite (1930-31) de Mario Peixoto qui utilise de brefs morceaux de Ravel, Debussy, Satie, Stravinsky, Prokofiev, qui viennent donner un climat au film selon des récurrences qui les font passer du leitmotiv à la boucle.
L’irruption du silence comme moment musical, trouve son équivalent dans le film lors des pauses au noir.
Comme le dit Antheil : « Le ballet mécanique, ici je m’arrêtais. Ici était le point mort, le bord du précipice. À ce moment à la fin de cette composition ou pendant de longs moments aucun son ne surgissait et le temps devenait moment musical , là s’accomplissait ma poésie, là j’avais enfin le temps qui se déplaçait sans y toucher. »
On remarquera que la musique d’Antheil comme nombre de propositions musicales contemporaines est influencée par le jazz, tel Stravinsky. On retrouve aussi chez ceux-ci la prépondérance de l’élément percussif. Tempo soutenu, scansion rapide qui n’est pas sans rappeler l’importance de la notion de rythme pour les cinéastes qui interrogent l’essence du cinéma. Ici je pense plus particulièrement à Hans Richter qui s’inspira largement des théories musicales et de l’analyse du contrepoint qui par la suite sera appliquée au cinéma.
Weekend 1930 Walter Ruttmann
Production Reichsrundfunkgellschaft et Berliner funkstunde
Composition musicale de Walter Ruttmann11 min 10
Rien n’était visible à l’écran, mais les images sortent des enceintes. Les spectateurs ne pouvaient plus croire leurs yeux, et les auditeurs mirent leurs mains sur leurs oreilles dans un état d’ahurissement. S’agissait-il d’un canular, de magie ou d’une erreur. En 1930 Walter Ruttmann réalisa un film sans images, un travail original dans l’histoire du cinéma. Le film invisible Weekend a été diffusé à la radio berlinoise le 13juin 1930, après une première présentation le 15 mai 30 puis ensuite, au cinéma et notamment au 2 congrès international du film indépendant de Bruxelles qui s’est tenu du 27 novembre au 1er décembre. 1930). Comme pièce radiophonique, Weekend est une curiosité. Il a été enregistré sur le ruban avec caméra et micro, selon les procédés nouvellement développés du système sonore appelé Triergon Massole à Mariendorff. Le son photographié était monté, coupé retravaillé sur la table de montage, Walter Ruttmann monta les sons comme il l’avait fait des images de son film Berlin, Symphonie d’une grande ville de 1927.
Pas d’enregistrement optique mais seulement un enregistrement acoustique.
« La pièce radiophonique se décompose en six parties
Jazz du travail Machines à écrire, sonnerie de téléphone, caisse enregistreuse, machines diverses, machine à dicter, scies, limes, forges, ordres
Jazz des bruits du travail, enjoué et presque purement musical ;
Contrepoint fortement travaillé rythmiquement
Contrepoint plus simple : chaque son est plus intensément caractérisé dans son aspect envahissant la machinerie gémissante du travail : dégoût, supplice du travail, fatigue, machine ritardando
L’arrêt du travail
Une horloge sonne, d’autres horloges sonnent en canon, des sirènes d’usines, éloignées, plus près, près.
Cadence de fermeture des machines, libératrice. On rabat les pupitres, on ferme les tiroirs, les stores, les grillages, un trousseau de clefs qui s’entrechoquent, on verrouille les portes, une clef qui grince en tournant dans le verrou.
Des voix humaines interviennent : des jeunes filles qui gloussent, des hommes qui rigolent, des cris « au revoir », murmurant, des pas pressés dans la cage d’escalier
La sortie à l’air libre
Parmi les éléments sonores du départ : mise en marche des motos et des voitures, sifflet de locomotive, sifflet et démarrage du tramway, des cris comme en voiture dépêchez-vous s’il vous plait, coup de sifflet du conducteur de train,, coup de klaxons et départ des voitures, signal du cor du postillon, claquement de fouets, départ de la locomotive. Tous ces sons vont recréer par le biais du montage une synthèse de départ, qui se décompose en un rythme mouvementé au sein duquel se superposent en contrepoint les bruits du train, des voitures du trot du cheval et des brodequins. Ce rythme est intégré à un chant de scout (la marche est le plaisir du meunier)
La pastorale
Au chant des scouts qui se perd au loin se mêle le chant d’un coq et d’oiseaux. Une chorale d’églises de village entame une série de complexes musicaux campagnards, qui vont se fondre spatialement les uns les autres, pendant que l’un s’évanouit dans le lointain, un autre va déjà croissant. L’orgue de l’église devient orgue de barbarie, auquel succède une ronde d’enfants, une ronde de paysans, avec cithare, fanfare de sapeurs-pompiers. Ces complexes vont s’articuler autour de sons de voitures qui passent, d’aboiements de chien, de caquetage d’oies etc. qui les couvrent en partie. Les cloches des vaches se fondent dans la sonnerie des cloches du village.
Reprise du travail
Le son des cloches est soudain interrompu par des sirènes d’usines. Réveils et sonnerie de téléphone hurlent. À cela succède dans un tempo accéléré la 2 partie inversée (l’arrêt du travail)
Jazz du travail
1e partie inversée. Reprise maladroite et sans enthousiasme du rythme de travail, marquée sentimentalement par des réminiscences sonores de la pastorale. »
Un crescendo permet de rejoindre le jazz du travail enjoué de la première partie. [3]
Au travers du montage et des fondus, Ruttmann transforma les sons originaux en mouvement et composa un rythme musical d’un week-end à partir de bouts de sons prélevés dans une ville contemporaine. Comme dans une séquence accélérée, le week-end est raccourci à une durée de quelques minutes et a quelques situations. On entend de bribes de conversation, des chansons et le bruit de machine à écrire. Au milieu de tout ça, un homme essaye de placer un coup de téléphone (on entend la voix de Ruttmann) et un enfant essaye de réciter le roi des aulnes. Les deux sont interrompus par le vrombissement d’une voiture de course, un sifflet,ou une sirène. Les sons et des éclats de bruits ne durant pas plus d’une fraction de seconde sont arrangés selon des associations de motifs. Un enfant dit « quatre fois quatre font : et la scène se transforme en une autre au quatrième étage d’un magasin d’alimentation. Le film acoustique de Ruttmann ne peut être vu sur le ruban. Tout n’est visible que comme signal optique. Les images sont produites dans l’imagination du spectateur.
[4]
« Il faut absolument distinguer l’esthétique du film muet de celle du film sonore, l’un devant subsister à côté de l’autre et le son ne pouvant jamais être considéré comme un complément de l’image. Il s’agit d’établir un contrepoint sono visuel indépendant, le son intervenant non pas pour exprimer plus complètement un geste, un événement, mais pour créer une impression globale originale. On peut ainsi imaginer, même dans un film romancé, des sonorités intervenant à contre rythme, l’image exprimant la cause et le son l’effet. » [5]
Ce film est important à plus d’un titre car il retrouve en dehors de ces innovations formelles la possibilité de créer une musique à programme. On n’est pas loin de la forme narrative qui décrit au travers le prélèvement de son un milieu, une atmosphère, un climat. Musique à programme. En ce sens nous ne sommes pas si, loin de la pastorale de Beethoven, ou de la Fantastique de Berlioz avec toutefois une différence de taille et tient au fait qu’ici se la partition n’a pas été écrite pour des instruments elle a été recueilli et à partir de l’ensemble des sons collectés un objet a été crées qui suit un canevas prédéterminé. Nous sommes au seuil d’un déplacement fondamental qui privilégie la récolte, la collection et qui du même coup évoque à la fois les techniques de montage quant à la structuration du divers des éléments. La synesthésie s’abolit par la surenchère que manifeste cette pièce radiophonique qui est aussi un film. Nous ne sommes plus en présence d’une relation arbitraire entre le son et les images, c’est nous au moment ou nous voyons qui fabriquons les images que nous donnent à entendre ces sons.
Colour Box 1935 Len Lye
Musique la belle créole interprétée par Don Baretto et son orchestre cubain
Montage son Jack Ellitt
Première projection 6 septembre 1935
Dans A Colour Box, la couleur est en surface sous forme d’arabesque de motifs colorés (apparemment justifié par la légère arabesque du petit air de danse qu’elle accompagne). Tout mouvement était un pur mouvement de couleur. [6]
Pour Len Lye, la beauté du film réside dans sa kinesthésie, c’est-à-dire la capacité qu’a le film à produire une sensation interne du mouvement.
La musique de ce film est La belle créole, une béguine (danse native de la Martinique qui était devenue populaire à Paris) composée par Don Baretto et son orchestre cubain. Ellitt en fit un organigramme (analyse) , puis la musique fut transféré sur le film et Lye reporta plusieurs indications le long de la bande-son. Puis il peignit les images directement sur le film transparent le long de la bande-son. Grâce à une année d’expérimentations, il ne lui était pas difficile de sélectionner et de peindre des idées visuelles pour une durée donnée. Lye peignit la plupart de Colour Box en cinq jours, n’y eu à faire que quelques collures, bien que la séquence de la fin avec les mots le ralenti considérablement. Le film ne prit au total que deux mois entre le moment de sa planification et sa réalisation.
La joyeuse musique de Colour Box le distingue de la gravité, du sérieux de la majeure partie des films d’avant-garde de l’époque. Lye ne souhaitait pas tant traduire la musique en image, mais de développer des idées visuelles en contrepoint. Il souhaitait avoir suffisamment de synchronismes afin de maintenir les images avec la musique mais pas suffisamment pour que leur danse soit prévisible. Il se sentait totalement libre vis-à-vis de ce qui dans la musique pouvait donner naissance à des idées, ainsi cela pouvait venir autant du rythme que du timbre, du style d’un joueur, l’atmosphère générale de la pièce, ou même,le rendu visuel de la piste sonore. Il avait l’habitude d’associer aux percussions des cercles et des points, alors que le piano se traduisait par des jets de courts traits colorés, les cordes avec les lignes tremblantes et frémissantes, mais il n’était pas à proprement parler rigoureux dans ces usages. Les lignes verticales (dessinées sur plusieurs photogrammes) étaient un motif favori qu’il utilisait pour une variété d’instrument.
Roger Horrocks
Il avait rencontré Jack Ellitt à Sidney et avait prévu de travailler ensemble sur Tusalava, pour lequel jack Ellitt avait réalisé une musique pour deux pianos, la difficulté d’avoir deux pianos pour la première du film s’ajoutait aux coûts de tirage d’une copie sonore entraîna l’annulation de l’accompagnement musical prévu.
Lye avait prévu de faire appel à Ellitt ou si cela n’était pas possible alors Eugène Goossen Rythme danse pour deux pianos.
Lot in Sodom 1931 James Watson & Melville Webber
Musique de Louis Siegel
Il avait été l’un des caméraman de The Fall of The House of Usher des mêmes cinéastes qui avaient alors fait appels à un autre musicien pour sonoriser ce film. Alex Wilder
Avec ce film et le suivant, les cinéastes qui nous concernent, sont à la fois des musiques savantes, mais cependant éloignés du métissage des genres et des cultures que préconisait la musique européenne des années 30. On ne sent aucune influence du jazz ou du cabaret. Nous ne sommes pas chez Kurt Weil, ni même Arthur Honneger, et pas plus chez Alban Berg, ou Ernst Krenek. Si l’instrumentation est similaire à celle de Weill qui privilégiant les vents, les projets ne relèvent pas de la même dynamique.
Musicien né en 1907 et mort en 1980, Alex Wilder est plus connu pour ces ballades et ses chansons populaires, ses travaux illustratifs qui mêlent référence au jazz et à la musique classique un peu à la manière de ce qu’il fera pour le film de Watson et Webber.
C’est en 1930 qu’il se fait connaître du grand public avec la chanson All the king’s Horses, qui a été inclus dans la revue d’Arthur Schwartz et Howard Dietz Three’s A Crowd.
Il a cependant écrit à côté de plusieurs centaines de chansons des pièces de musique plus sérieuse telle qu’une sonate pour flûte, tuba et basson, un concerto pour saxophone, des quintettes pour divers instruments , des pièces pour piano, quatre opéras, le ballet Juke Box et un grand non de pièces peu orthodoxes comme as « A Debutante’s Diary« , « Sea Fugue Mama« , « She’ll Be Seven In May« , « Neurotic Goldfish« , « Dance Man Buys A Farm« , « Concerning Etchings« , « Walking Home In The Spring« , « Amorous Poltergeist » and « The Children Met The Train« .
L’une des caractéristiques de la musique de Alex Wilder est qu’elle a souvent été considérée comme pas assez jazzistique pour les jazzmen, pas assez intellectuels ou classiques pour appartenir vraiment à l’avant-garde ; sa musique est hybride, pas assez ci, pas assez ça. Elle est proche en cela des films de Watson et Webber qui sont considérés comme des travaux hybrides. L’une des caractéristiques de son travail comme celui de Watson et Webber et de situer entre les genres, de n’appartenir à aucune catégorie mais d’en façonner de nouvelles par la juxtaposition, l’annexion de courants divers. Ces artistes ne sont pas de ceux qui établissent de nouveaux systèmes, ils sont ailleurs, ils produisent des conglomérats, ils sont en dehors de l’officialité et des clichés modernistes. Ils travaillent à la lisière néo-classique, recyclant indifféremment mais pas sans talent des matériaux de provenances éparses.
Non sans certain humour Whitney Balliet qualifie Alex Wilder d’artiste de l’arrière-garde alors que pour la plupart des critiques classiques il appartient à ces artistes conservateurs qui puisent leur génie dans leur faculté à produire une musique en dehors du temps.
Son travail musical est un amalgame des archétypes de trois compositeurs : Gershwin, Poulenc et Villa-Lobos. De Gershwin , il a cette faculté étonnante d’écrire des chansons, de Poulenc il reprendrait l’usage d’élément populaire de jazz et de Villa-Lobos il a cette facilité d’écritures .
Le travail de Lois Siegel, souligne son appartenance à une musique des années 30, qui mêlent les genres et ne fait pas ici non plus preuve d’une grande innovation compositionnelle. On remarque cependant un grand nombre de techniques similaires à un montage cinématographique, comme si le montage est tout ce que cela inclus comme mode de pensée et d’acte se retrouvait au sein du discours musical. Il s’agit somme toute d’une musique écrite pour le film, après que le film fut réalisé et qui utilise à la fois les changements de thèmes d’orchestration selon ce qui se passe à l’écran mais aussi coupure dans le morceau afin de passer à une autre idée, similarité dans l’idée d’une polyphonie instrumentale qui évoque les différents éclats, les surimpressions.
La musique composée par Lois Siegel mêle des vents et des percussions, le group instrumental est peu usuel. La musique est parfois disharmoniques, mais de manière légère.
Le son qui accompagne le film fait se succéder des étirements, des groupements d’instruments desquels émergent une voix dominante vaguement disharmonique. L’usage ponctuel de la voix comme instrument préfigure un peu ce que font Harry Parch et Virgil Thomsom.
On est en présence d’un son qui utilise des techniques d’assemblage et de compositions cinématographiques. Souvent les thèmes se succèdent selon des coupes franches. Comme si le motif avait été arrêté et ne pouvait continuer, laissant la place à un autre thème distinct.
On est en présence de conflagration, de juxtaposition, d’ éclat. La musique fait plus preuve d’un montage, quasiment un assemblage d’éléments qui partagent des tonalités similaires, et en ce sens elle partage avec les compositions de Francis Poulenc cette multiplicité de thèmes, s’additionnant les uns les autres pour parfois ressurgirent selon des alternances qui évoquent des techniques de montage alterné voir la scène du cauchemar.
Il n’y a pas de continuité thématique, mais des ressemblances tonales, des rencontres instrumentales qui se détachent comme le ferait l’alto, le violon occupant brièvement la position de soliste, ou plus exactement pour filer la métaphore cinématographique, occupant le premier plan telle une surimpression dominant les autres avant de se fondre dans la masse instrumentale, et visuel.
La musique cède la place lorsque se font entendre les psalmodies de Lot.
L’une des figures dominantes dans la composition est la superposition des thèmes, cascades de thèmes percussif, alors que l’autre soulignerait l’amplification de l’instrumentation.
On peut remarquer de plus qu’entre Lot in Sodom et Fireworks il existe sur une séquence (celle qui voit les entrailles d’un corps fouillé par une main) dans laquelle la musique est proche. Dans les deux films, la musique accentue le lyrisme de la scène, mais chez Kenneth Anger, ces sont les pins de Rome Respighi qui font le lien, alors que chez Watson et Webber c’est la même musique de Lois Siegel.
Les influences sont nombreuses, certes, on pensera parfois à Igor Stravinsky, mais aussi à Claude Debussy brièvement pour les scènes rapides qui nous montrent l’eau.
Magyar Triangulum 1937 Sandor Laszlo
Musique de Franz LisztetSandorLaszlo
Le pianiste, compositeur hongrois Sandor Laszlo né en 1905 a poursuivi une recherche similaire à celles d’Harwig et Hirschfeld Mack dans la production de compositions lumineuses en couleurs. D’après Laszlo Moholy-Nagy, les travaux d’Alexander Laszlo sont quelques peu obscurcis par les théories historiques qui les accompagnent, en effet elles sont trop basées sur des déclarations subjectives descriptives quant aux relations entretenues par le son et la couleur.
« L’une des idées de Laszlo est que la couleur n’a pas d’équivalent dans un seul son, une note mais dans ensemble complexe de sons. Son piano de couleurs est opéré par un assistant qui projette les couleurs sur l’écran alors que lui-même joue. Le piano de couleurs ressemble à un harmonium, avec ces touches et registres auquel aurait été ajouté quatre projecteurs. Les figures des diapositives montrées proviennent des procédés Uvachrome et sont projetées au travers de 8 prismes de couleurs dans chaque couleur (dans chaque projecteur il y a 8 prismes de couleur) selon l’addition ou la soustraction des couleurs. Les projecteurs équipés de condensateurs fonctionnent de la manière suivante
1 un système de changement de diapos vertical et horizontal
2 un cylindre entre le soufflet et l’optique afin de pouvoir les 8 clefs de couleurs
3 un iris, diaphragme dynamique qui puisse réguler l’intensité de la lumière et les effets lumineux
4 un diaphragme pour délimiter la lumière
Les motifs obtenus par les quatre projecteurs, reprennent les procédures pour montrer des diapositives et changement et sont mises en marche ou éteints.« .
[7]
Alexander Laszlo n’a réalisé qu’un film en 1937. Il avait auparavant conçut ce projecteur de son et lumière avec l’assistance d’Oskar Fischinger. Il a publié en 1924 un ouvrage intitulé Farbkichmusik (couleur- lumière -musique) dans lequel il donnait les plans pour la construction d’un orgue de couleur qui pourrait projeter des couleurs tandis qu’il jouerait ses compositions au piano. Après un premier essai jugé peu concluant par les critiques, il fit appel à Oskar Fischinger qui imagina un film qui pourrait accompagner les projections lumineuses d’Alexandre Laszlo. Les propositions de Fischinger furent bien accueillies au point qu’elle semble avoir éclipser les compositions musicales post romantiques de Laszlo. On leur préférait les effets cinématographiques de Oskar Fischinger qu’il continua de développer indépendamment. Il réalisa différentes compositions au moyen de plusieurs projecteurs 35mm et seul nous reste d’après Bill Moritz R-1 ein Formspiel (un jeu de formes).
Ce court film, en noir et blanc, appartient à cette esthétique hybride des années 30 qui voit se côtoyer un nombre d’esthétique diverses. Ici la comédie musicale à la Busdy Berkeley se mêle au clip musical, et préfigure une expérimentation visuelle intense. L’utilisation de »found footage » autant que les effets visuels sont caractéristiques du projet. Le film se divise en trois parties.
La première nous propose une polonaise de Liszt ou les sœurs Kotanyi jouent côte à côte cette polonaise.
La seconde Alman Kiralya Budapest nous propose une musique dansante selon un rythme de valse, les pianistes sont placés afin de former une étoile, il s’agit d’une première composition de Laszlo.
Dans cette partie, il est intéressant de constater le travail effectuer par Laszlo avec les textes de la chanson qui barrent les plans de nuits des rives du Danube selon des dynamiques graphiques qui se répondent d’un intertitre à l’autre…
Textes groupés, parfois sur deux lignes et qui inscrivent une autre dynamique dans l’image, un aplat, faisant de l’image un fond comme l’est l’image pour la musique dans ce film.
Dans la troisième partie, (Huzdra cigany) les pianos des trois sœurs est soudé en un piano géant qui évoque les décors délirants de Berkeley, mais sans l’exubérance camp de ce dernier. Leurs jeux s’effectuent sur une autre composition de Laszlo qui fait appel à un « csardas », une musique hongroises très rythmée.
Il s’agit presque d’un vidéo-clip et évoque à la fois le travail de Germaine Dulac : celles qui s’en font et ceux qui ne s’en font pas tous deux de 1930. mais à la différence de Germaine Dulac, ici nous sommes en présence de kitsch, nous sommes dans l’excès, une certaine mesure d’effets.
C’est la première partie qui est visuellement la plus riche. Les effets sont nombreux, qu’ils s’agissent des ouvertures aux moyens de miroir, d’iris sur le visage d’un tromboniste, des balayages latéraux…
On retrouve un hommage à Duchamp lorsqu’un disque rotatif sur lequel un clavier en spirale tourne en surimpression avec la chef d’orchestre.
Dès cette première partie sont annexés des films de « found footage », documentaires de guerre, dont certains plans proviennent d’un film d’Eisenstein, ces mêmes plans se retrouvaient d’ailleurs annexés dans une version d’Anemic Cinema de Marcel Duchamp qui circulait aux Etats-Unis chez un distributeur californien.
Dans les deux autres parties du film d’autres types de « found footage » seront annexés, plus proches du documentaire sur la Hongrie et ses clichés, sauf pour la fin de la première partie dans laquelle un ensemble de séquences tirés d’un film à costumes.